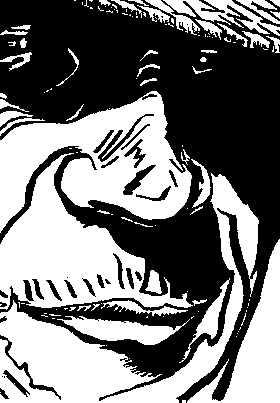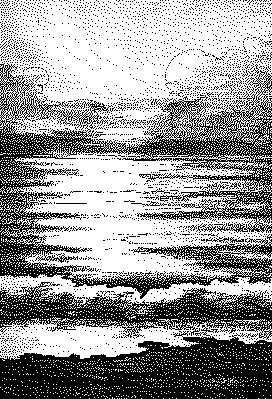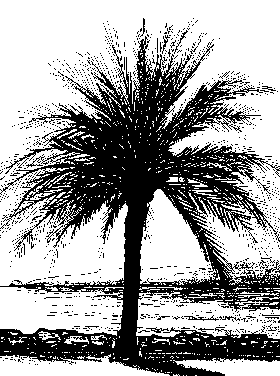Afrique du Nord
voyage en voilier
par
Olivier Gonet
Regardez, elle brille dans les yeux de cette
paysanne espagnole rencontrée au détour d'un chemin de terre rouge, elle vit
dans les gestes de cette brave italienne qui triture des tomates au fond d'une
ruelle aux ombres bleues-violettes.
Regardez ce paysan assis à l'ombre fragile d'un amandier noir qui perd une poignée de pétales blancs à chaque bouffée de vent. Bien calé sur une chaise de paille, un verre de vin à portée de la main, il tourne une longue cuillère de bois dans un pilon qui contient des jaunes d'oeufs. Goutte à goutte, il fait couler de la belle huile d'olive blonde puis il ajoute de l'ail pilé en quantité suffisante pour faire blanchir son ailloli. Un coup d'oeil pour mesurer le poivre et la goutte de vinaigre de la fin. Cela peut se manger avec des pommes de terre cuites au feu et c'est merveilleux.

Huile sur toile (73 x 90 cm.)
O.Gonet
Et le petit monde des marins?
- Connaissez vous la pêche au thon? me
demande un ami espagnol.
Je connais bien sûr la vie de ces bateaux de
pêche tout griffés, tout usés par le travail des hommes et de la mer.
- Non non!, je veux parler de la pêche au
filet. Allons voir cela! Et nous voilà partis.
Un village, au sud de Carthagène. Ou plutôt
une volée de petites maisons blanchies à la chaux, qui dégringolent de la
falaise jusqu'à l'eau violette où de gros carrés de pierre, mis tout de
guingois, forment comme une espèce de débarcadère.
Flottant sur l'eau claire, il n'y a pas plus
d'une demi-douzaine de petits bateaux à rames.
Quelques familles de pêcheurs, quelques
vieilles bonnes femmes portant sur la tête des chignons gros comme des crottes
de bique et, à la sortie de l'école, une poignée de gamins aux sourires
ébréchés qui font des bêtises avec un bidon crevé.
Nous sommes en Juin, la saison du thon. Tous
les pêcheurs se sont placés sous l'autorité commandeuse de Joaquin. C'est le
roi d'Ithaque. Il est un peu vieillissant mais c'est encore un fier barbu aux
yeux charbonneux. Il règne sur un petit peuple de pêcheurs qui sont presque
tous de sa famille. Ils ont installé, au large du village, un gigantesque filet
de plusieurs kilomètres, largement ouvert au passage espéré des bancs de thons.
Ce filet, fixé sur le fond par un chapelet d'énormes ancres de caravelles, se
finit en une vaste chaussette de ficelle.
Maintenant, ils attendent, assis sur le quai,
en chuchotant comme à l'église. Au loin, l'un d'entre eux guette, immobile sur
un petit bateau. Et cela dure parfois plusieurs jours, parfois plusieurs
semaines.
Soudain, un matin, un soir, n'importe quand,
la chaussette se remplit d'un seul coup d'une masse éclatante de vie. Les thons
sont arrivés!
Alors, on se précipite. C'est la grande
boucherie.
Et puis, c'est la fête au village. Pinard,
guitare et boustifailles. Le roi d'Ithaque est célébré autant que taquiné par
le bataillon des veuves qui rient comme si elles allaient s'envoler.
Seul sur la falaise, et malgré les lazzi des
fêtards, la silhouette noire d'un berger n'a pas bougé d'un pouce. Le vent, qui
flotte dans mes cheveux, fait courir des traînées de nuages dans le paysage.
Des aiguilles de soleil fuient au loin sur la mer frissonnante de lumière.
C'est cela que j'essaye
de peindre aujourd'hui et, malgré les années qui passent, j'y prends un plaisir
toujours neuf.
* * *
Il y a vingt ans, en 1965, au large de la Libye du roi Idris, je naviguais à bord du voilier océanographique l'ATUANA. En ce temps-là je dirigeais, avec mon ami Max et une petite équipe de marins et de techniciens, un programme de recherches archéologiques sous-marines.

L'Atuana, mon cher et vieux voilier en Méditerranée
Dans le fameux golfe de la Grande Syrte,
entre Tripoli et Bengazi, le mauvais temps nous est soudain tombé sur la tête.
Depuis l'antiquité, depuis Homère et l'Odyssée, la mauvaise réputation du golfe
de Syrte n'est plus à faire. Au temps des galères et des amphores, on se
méfiait tellement qu'en hiver, à la mauvaise saison, les marins préféraient
tirer leurs bateaux au sec et attendre paisiblement le printemps. Aujourd'hui
encore, les livres d'instruction nautiques sont pessimistes. Des vents violents
soulèvent une sale mer creuse et courte. Surtout en hiver naturellement. Et
nous étions en janvier. Mais quoi, il fallait bien passer par là pour continuer
le voyage et nous avions déjà du retard sur le programme.
Lorsque le vent mauvais arrive en hurlant, il
y a tout de suite des vagues venimeuses. Elles se froissent le long de la coque
du voilier complètement couché sur la mer. A l'intérieur, Béchir, notre
cuisinier, prépare le dîner mais la gîte est si forte qu'il se tient debout sur
la paroi de la cabine, le dos calé contre le plancher presque vertical.
Et la mer se creuse encore.
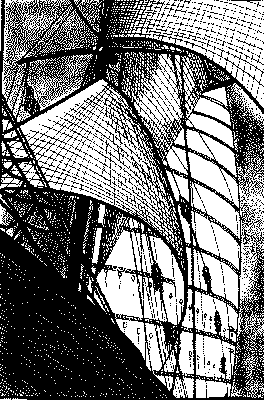 Les embardées
du bateau provoquent maintenant des secousses à la fois lentes et brutales dont
la force est inimaginable pour qui n'a jamais navigué. Les armoires du salon
s'ouvrent d'un coup et vomissent, pèle - mêle, provisions, vêtements, livres et
Dieu sait quoi encore. Pour compléter le désastre, une rangée de bouteilles de
vin rouge vient se fracasser sur la marmelade des objets qui roulent déjà dans
le salon.
Les embardées
du bateau provoquent maintenant des secousses à la fois lentes et brutales dont
la force est inimaginable pour qui n'a jamais navigué. Les armoires du salon
s'ouvrent d'un coup et vomissent, pèle - mêle, provisions, vêtements, livres et
Dieu sait quoi encore. Pour compléter le désastre, une rangée de bouteilles de
vin rouge vient se fracasser sur la marmelade des objets qui roulent déjà dans
le salon.
Dehors, le ciel noir commence à vingt mètres
au-dessus des mâts. Il pleut horizontalement. Le problème est surtout de ne pas
se perdre. Or, dans ce chaos liquide, on n'y voit rien du tout. A cette époque,
le repérage par satellite n'existait pas encore. Le ciel complètement couvert
empêche d'utiliser le sextant. Reste l'appareil de radio- goniométrie et
surtout la bonne vieille navigation à l'estime. Malheureusement, avec le
mauvais temps la précision diminue et après cinq ou six cents kilomètres de
mer, vient le moment où il faut bien avouer que l'on ne sait plus très bien où
l'on est.
Et c'est un aveu très désagréable à faire sur
un bateau pris dans le mauvais temps.
Je me souviens des heures passées devant
notre appareil gonio à rechercher des émissions de radio-phares. C'était un
gros meuble de métal gris. Deux cadrans verdâtres me regardaient bêtement. Sur
le flanc, l'oreille suspendue d'un téléphone en bakélite noire, tout usé par le
sel.
Au milieu de la troisième nuit, nous avons
enfin capté l'émetteur de Bengazi. Et c'est en suivant sa direction que,
finalement, l'un d'entre nous aperçut l'entrée du port à travers le rideau de
la pluie.
C'est un plaisir fin et toujours neuf que
d'arriver en bateau à voile, depuis les vastes espaces libres de la mer et
d'apercevoir quelques détails de la terre qui semble toujours perdue dans le
grand océan.
C'est d'ailleurs un plaisir aussi vieux que
le métier de marin. Pendant le voyage, la mer fut difficile ou amicale, la vie
à bord fut monotone ou violente mais toujours, la perspective d'arriver évoque
la même fête.
Une fois l'ancre mouillée et bien accrochée
sur le fond, les voiles descendues et repliées sur les baumes, on court à terre
pour voir les gens, les arbres et les choses. Pour écouter, sentir et boire la
vie qui vous éclate au visage.
Mais d'abord, il faut affronter la douane!
Un petit bouquet de pâquerettes, piqué dans
un verre à dent, orne la table du gros fonctionnaire enturbanné qui nous
tourmente de ses curiosités administratives. En tirant la langue et en
respectant soigneusement les marges d'une feuille de cahier d'écolier
quadrillée en bleu-ciel, il écrit nos réponses avec une plume de fer plantée
sur un bout de bois tout rongé de ses hésitations. Derrière lui, s'accumule
comme le début d'un petit fortin de papier. Des pavés de feuilles exactement
pareilles, les réponses obtenues de tous les bateaux qui nous ont précédés ici
depuis Dieu sait quand. Pour ne pas en rire et risquer de le vexer, j'évite de
lui demander qui est supposé relire tout ce fatras. Çà, c'est l'un des
inconvénients des cultures méditerranéennes: Le goût des lois, des juristes et
des fonctionnaires y est plus salé qu'ailleurs. Les grosses fesses flasques de
la statue du scribe assis depuis quatre mille ans à l'entrée du tombeau de
Toutankhamon sont toujours tièdes et vivantes, même dans les administrations
modernes.
Quelques jours plus tard, nous reprenions la
mer.
A l'Est de Bengazi, qui est une assez grande
ville piquetée de minarets, les dernières maisons et les dernières poubelles
s'égarent dans le désert qui recommence. Un désert de roches pulvérulentes et
de sable caillouteux. Par endroits, quelques buissons tout secs dessinent
encore le lit ancien d'une rivière morte depuis longtemps. Le tour romantique que
prend parfois l'aventure me montait un peu à la tête. Comme une illustration de
vie heureuse, le voilier filait, nerveusement incliné. Un tangage très lent et
de beaux bruits de vagues bleues- violettes qui déferlent sous la coque.
J'allais m'étendre dans le filet suspendu sous le beaupré et là, j'écoutais
gronder l'étrave qui taillait sa route. Sur ma tête, un nuage de cent
quatre-vingts mètres carrés de voiles blanches, un gribouillis compliqué de
filins et un mât qui grince en s'inclinant sous les rafales de vent.
Le bonheur simple de la navigation par beau
temps.
Le bateau s'éloigne un peu de la côte. La
terre s'estompe à l'horizon. Il n'y a plus que le ciel violet et la mer plus
violette encore.
Quelques heures plus tard, la terre
réapparaît.
Nous apercevons bientôt le sourire des ruines
blanches d'Apolonia. C'est là que nous allons.
Au temps antiques, Apolonia fut le port
luxueux de la luxuriante Cyrénaïque. Aujourd'hui, la ville est morte depuis
longtemps et l'ancienne colonie, n'est plus
qu'un désert vaste, blanc et solitaire. Mais la force poétique de cet endroit
est à vous couper le souffle.
D'abord, il y a les murs massifs du port. Ils
protègent les eaux vertes d'un assez grand lagon d'où émergent trois collines couvertes
de ruines. Elles sont faites d'une pierre si blanche qu'on les dirait chaulées
de frais. Au sommet de chaque colline, les troncs blancs d'un temple mort.
Au fil des millénaires, la côte de Libye a
subit des mouvements géologiques extrêmement lents. Ici, ce fut un léger
enfoncement, quelques mètres d'affaissement au-dessous du niveau de la
Méditerranée. Les trois collines qui autrefois dominaient la ville d'Apolonia
ne sont plus que trois petites îles entourées d'eau. Tout le reste est inondé.
Au flanc de l'une des îles, il y a comme la
trace crayeuse d'une gigantesque morsure: les ruines d'un vieil amphithéâtre en
demi lune. Lui aussi, évidemment, s'est enfoncé partiellement sous les eaux
mais la partie haute des gradins émerge encore. Elle dessine une sorte de
petite crique bien abritée du vent.
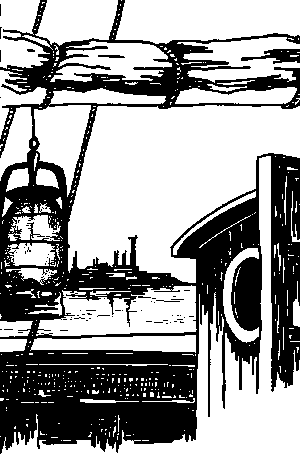 C'est là, au
centre de la scène, que nous avons jeté l'ancre.
C'est là, au
centre de la scène, que nous avons jeté l'ancre.
Le bateau, comme entouré de spectateurs
absents, se balance au-dessus de son ombre.
Juste à côté du théâtre, des rues sortent de
la mer, se prolongent sur le rivage, grimpent la colline et aboutissent en
apothéose près d'une ordonnance de colonnes blanches dressées sur un tapis
écorné de mosaïques. C'est l'un des trois temples sur les collines. Une
atmosphère de vacarme éteint, de grouillements immobiles. Sous l'eau, le
spectacle continue. Des rues, des magasins, des ateliers d'artisans d'où
s'envolent des bancs de poissons. La plus grande partie inondée de la ville est
probablement enfouie pour toujours sous le sable du lagon mais quelques quartiers
ont été protégés de l'usure des vagues par la masse du port en ruines.
C'est un port de type phénicien. Comme à Tyr,
sur la côte libanaise, il est divisé en deux parties bien séparées: l'une
ouverte sur la mer, l'autre, plus petite, cernée de murailles défensives contre
les ennemis venus du large. C'est là, au fond de ce second port, que se
trouvent, magnifiquement conservées, les installations de réparation et
d'hivernage des bateaux. Le golfe de Syrte est tout près. Les galères antiques
attendaient ici la fin de l'hiver pour s'y risquer.
Apolonia, ville morte, capitale d'une terre
morte.
Et pourtant, venus de Dieu sait où, une
douzaine d'olibrius à la mine patibulaire nous observent de loin. Inutile de
s'y frotter. La nuit tombée, il vaut mieux se mettre à l'abri du bateau en
écoutant les histoires que raconte Béchir, notre cuisinier tunisien. Nous
l'avons engagé quelques semaines plus tôt, lors d'une virée au "Grand Café
de Paris et des Colonies", à Tunis. Un petit bonhomme parfaitement gris à
part son menton sali de barbe.
Pendant toutes ces soirées, sous les étoiles,
juste à côté de la frange noire des ruines d'Apolonia, il nous raconta, sans le
savoir, des histoires qui sortaient tout droit de l'Ancien Testament: un Moïse,
en djellaba, traversait la Mer Rouge à la faveur des miracles d'Allah!. Il y
avait aussi l'histoire d'un espèce d'Hérodote tunisien qui découvrait les
pyramides d'Égypte sans savoir qu'elles étaient des tombes. Et puis,
d'interminables contes de guerriers sahariens. Les années ont passé depuis nos
soirées à bord de l'ATUANA ancré dans l'amphithéâtre d'Apolonia. Seules
quelques images nostalgiques surnagent encore dans ma mémoire. Celle d'une
princesse merveilleusement pure et belle. Pour la décrire, Béchir nous
racontait qu'elle avait un sexe pareil à l'empreinte d'un sabot de gazelle sur
le sable du désert.
Et pendant ce temps là, une grosse bécasse de
lune rousse se levait à l'horizon. Dans cette lueur nouvelle, le quinquet
fumeux allumé sur le pont n'éclairait plus guère que nos verres de vin rouge.
|
|
Portrait de Béchir
par O.Gonet (dessin à la plume)
L'île de Chypre, mai 1967,
Minuit sonnait à un clocher de village
dissimulé derrière la côte, lorsque quelques mois plus tard, nous jetâmes
l'ancre dans une petite crique au Sud de l'île de Chypre. Nous arrivions
directement du large et nous étions bien fatigués. Une nuit de sommeil était
nécessaire avant d'affronter la douane du port de Famagouste, ancienne capitale
et port principal de l'île.
Cinq minutes plus tard, tout dormait à bord.
A l'heure des premières lueurs humides de
l'aube, un choc contre la coque nous réveille en sursaut. C'est un petit bateau
à rames monté par un grand escogriffe aux énormes moustaches tremblantes de
fureur. Et le voilà qui nous fulmine dans une langue aussi rocailleuse
qu'incompréhensible. L'index qu'il brandit en direction du large est le plus
clair de ce tonnerre de rage. Il veut nous voir déguerpir et à l'instant même.
Pierre, notre photographe zurichois, qu'il ne fait pas bon réveiller en
sursaut, jaillit tout ébouriffé sur le pont et, immédiatement, déverse sur le
bonhomme un torrent d'injures en pur suisse- allemand.
Sur sa périssoire, le noble cypriote en tombe
assis d'étonnement. Sa colère refroidie, il nous explique, en anglais
rudimentaire que, par hasard, nous avons jeté l'ancre au beau milieu de la
ligne de front qui sépare les partisans cypriotes grecs, des partisans
cypriotes turcs. Les uns sont sur la rive droite, les autres sur la rive
gauche. Au lever du soleil, la guerre recommencera et nous gênerons. Ah, chère Méditerranée dont l'humanisme résiste même aux
guerres civiles!
Bien sûr, nous laissons ces fiers guerriers
s'entre égorger comme ils l'entendent et nous allons mouiller dans le port de
Famagouste.
Famagouste, c'est un bizarre mélange de
village grec, de marché turc et de colonie anglaise. Les anglais, en culotte
courte, un casque en forme d'assiette à soupe renversée sur la tête,
s'efforcent, aimablement, de séparer les musulmans des orthodoxes qui se
détestent depuis des générations.
* * *
Nous sommes venus à Chypre pour observer la
structure géologique des fonds marins. Et pour cela, nous avons choisi de
mouiller au Nord-ouest de l'île, dans la très jolie baie de Krisokhou.
A part son organisation politique branlante,
l'île de Chypre est absolument charmante. Des rivages ourlés d'écume, comme
disait Homère. L'île de la déesse de beauté, dit-il ailleurs.
A deux pas de notre mouillage, derrière un
rideau de pins penchés sur la falaise, au bout d'un sentier de poussière rouge,
on arrive à un village. Lorsque nous débouchons sur la place, les bouches et
les moustaches s'arrondissent d'étonnement. Des étrangers! La vie s'arrête net.
Nous sommes l'événement annuel de ce petit monde où il ne se passe jamais rien.
Un bistrot aligne trois tables rondes et
quelques chaises de paille. Le trot léger des petits ânes enfouis sous de
considérables chargements de légumes, fait trembler les verres d'anisette que
le garçon du café, un fier vieillard dont le fond de culotte pend jusqu'aux
genoux, a posé devant nous.
|
|
Portrait d'une brave paysanne rencontrée à Chypre
par O.Gonet (dessin à la plume)
Une insignifiante blessure, que je m'étais
faite sous l'ongle d'un pouce, s'était infectée et, depuis une semaine,
mûrissait en vilain panaris rougeâtre et brûlant. J'en souffrais d'autant plus
que, par je ne sais quelle malchance, chaque geste me faisait heurter du pouce
malade l'objet pointu ou tranchant placé à portée de ma main. En brandissant
mon pouce sous le nez des passants et en articulant soigneusement quelques mots
d'anglais colonial, je cherchais à m'informer sur un éventuel secours médical.
Miracle! il y avait deux médecins dans le village.
L'un par ici, l'autre par là.
Et tous les gens que j'interrogeais
m'affirmaient avoir été arrachés à des morts certaines par l'un ou l'autre de
ces deux savants. Au hasard, je choisis celui qui vivait par ici et, en suivant
de touffues indications topographiques, j'aboutis à une charmante petite
baraque en bois, plantée un peu de guingois, dans un jardinet de mauvaises
herbes. Juste à l'entrée, la chèvre de Monsieur Seguin paissait autour de son
piquet.
C'était bien là. D'ailleurs, le savant
vieillard à lorgnon qui m'accueillit avait bien l'expression de compétente
gravité propre aux professions médicales. A vrai dire, son cabinet de
consultation ressemblait à la cabane à outils de mon grand'père: un sol de terre
battue, une odeur de sac de pommes de terre. Il y avait, en revanche, une
cuvette émaillée sur une table et un authentique squelette humain pendu par le
cou à l'espagnolette de l'unique fenêtre. Je ne compris rien du tout au
discours du médecin. D'ailleurs je ne l'écoutais même pas, j'avais trop peur de
reconnaître les mots de "purge"ou de "saignée". Eh bien
non! il pencha finalement pour une raisonnable piqûre de pénicilline.
Après avoir tendu mes fesses à la seringue,
je l'invitais à célébrer ma future guérison au bistrot de la place où il
m'accompagna avec enthousiasme. Peut-être profita-t-il de l'occasion pour
démontrer à ses clients villageois qu'on venait le consulter même depuis
l'étranger.
Quelques jours plus tard, comme je ne
constatais guère d'amélioration, je décidais d'essayer l'autre praticien. En
arrivant chez lui, je le découvris derrière sa maison, le torse nu et puissant,
occupé à des exercices d'athlétisme. Il soulevait, en ahanant, d'énormes
haltères. Comme j'applaudissais poliment, il profita de ma présence pour forcer
un peu son talent et soulever d'un seul bras ce qui normalement exigeait la
totalité de ses forces.
Un expansif celui-là, il exerçait la médecine
dans la joie. Mon panaris, si gonflé que je m'y sentais battre le coeur, le fit
hurler de rire. Sa main énorme sur mon épaule, il me conduisit directement dans
son cabinet où, muni d'une paire de ciseaux de couturière, il trancha dans le
vif.
Le jet de pus arrosa le plafond. Mais je fus
guéri à l'instant.
* * *
11 heures du matin. Le spectacle s'anime, le
dentiste vient d'arriver. Le voilà grimpé sur sa charrette toute peinturlurée
de réclames écaillées. Une pince au poing, il soigne sa réputation en vantant
la légèreté de son tour de main professionnel. Extraction sans douleur, on ne
sent rien du tout. Et pour le démontrer, il esquisse dans l'air un geste d'une
merveilleuse facilité.
Autour de sa charrette, il a disposé un
étalage de paniers remplis de dentiers pour toutes les tailles. Garantis en
vraies dents. Un assistant aide à chausser les appareils à l'essais. Le choix
fait, il tend un miroir pour juger de l'effet des sourires tout neufs.
Derrière le charlatan, au fond de la place,
une petite église orthodoxe se dissimule dans les branches d'un énorme
eucalyptus. Là-dedans, tout n'est que fraîcheur et obscurité. Quelques vieilles
aux savates poussiéreuses, marmonnent des prières devant une bougie.
* * *
A bord du bateau, le travail scientifique
continuait, monotone comme presque tous les travaux scientifiques. Des milliers
et des milliers de chiffres lus sur les cadrans de nos appareils de mesure. Des
chiffres sans aucun intérêt immédiat. Ils n'auront de sens que plus tard,
reportés sur des cartes géophysiques.
Heureusement, il fallait aussi plonger très
souvent pour vérifier la bonne marche des appareils que nous traînions derrière
le petit bateau à moteur ou pour les décrocher lorsqu'ils se coinçaient entre
deux rochers chevelus.
En plongeant ainsi, nous avions remarqué,
tout près du bord, une espèce de falaise sous-marine entièrement faite de
débris d'amphores cassées. Un véritable pouding solidifié de plusieurs mètres
d'épaisseur, étalé sur des kilomètres de longueur. Une telle masse représentait
une quantité d'amphores beaucoup trop importante pour une si petite province.
Quelques semaines plus tard, je quittais
provisoirement le bateau pour donner à Londres une conférence sur le résultat
de nos travaux en Libye et, par hasard, je parlais aussi de cette accumulation
de vieille vaisselle sous l'eau de l'île de Chypre. Un jeune archéologue anglais
fut intéressé par ce détail et il me posa, à ce sujet, des questions beaucoup
trop savantes pour moi. Je m'en débarrassai en l'invitant tout simplement à
bord du bateau pour qu'il puisse voir lui-même de quoi il s'agissait.
Dès notre retour à Chypre, il se mit donc à
travailler sur ce curieux pouding en remplissant sa cabine d'innombrables
échantillons soigneusement numérotés. Et c'est lui qui, finalement, nous
expliqua le sens de cette antique poubelle sous-marine.
Il faut savoir que la réputation agricole de
l'île de Chypre remonte à l'antiquité mais elle est sujette à des sécheresses
qui, au temps d'Homère, faisaient déjà le désespoir des maraîchers. En
revanche, juste en face, à cinquante milles au nord, la côte turque, qui est
très pauvre et presque inhabitée, reçoit en abondance l'eau des fleuves venus
d'Anatolie pour se perdre bêtement dans la Méditerranée. Depuis le fond de la
civilisation, il existe donc un courant d'importation d'eau douce entre la
Turquie et l'île de Chypre. De l'eau transportée à la rame et naturellement
dans des amphores.
|
|
dessin à la plume de O.Gonet
Dans l'antiquité, les amphores n'étaient
probablement pas un emballage très coûteux. Mais elles nécessitaient quand même
l'exploitation de mines de terre glaise de bonne qualité. Or, sans être rares,
ces mines ne sont pas si communes le long des côtes de la Méditerranée qui est
relativement sèche. Ensuite, il fallait le travail d'un bon artisan et puis du
bois, relativement cher lui aussi, pour cuire la terre. Il fallait enfin
transporter et vendre les amphores neuves. Bref, sans être très coûteuses,
elles devaient représenter quand même un petit capital non négligeable. Alors,
bien entendu, et comme on le ferait aujourd'hui encore entre gens raisonnables,
on essayait de les faire durer. Elles ne servaient tout d'abord qu'à
transporter des produits nobles et chers : de l'huile d'olive ou du vin par
exemple. Malheureusement, après quelques voyages, elles sentaient le vinaigre
ou l'huile rance. Alors, on les revendait d'occasion au meunier, par exemple,
pour transporter du grain. Et puis, lorsqu'elles avaient perdu une anse ou
qu'elles avaient le col fendu, le meunier les revendait encore. Ainsi de suite
jusqu'à ce qu'elles aboutissent, toutes sales, toutes usées et toutes moches
sur la côte turque où on les revendait encore, mais cette fois pour presque
rien, aux rameurs cypriotes venus chercher de l'eau douce.
Cinquante milles à ramer pour retourner à
Chypre, ce n'est pas considérable mais, tout de même, il fallait le faire et
les galères étaient beaucoup moins pesantes à la rame lorsque la cale était
vide.
Alors, une fois l'eau douce versée sur les
légumes cypriotes, et pour s'éviter la peine de ramener ces lourdes vieilleries
jusqu'en Turquie où elles ne valaient presque rien, on les balançait tout
simplement par dessus bord.
Et cela dura des siècles. Le temps
d'accumuler cette véritable falaise sous- marine de débris.
J'ai reçu récemment le livre que publia notre
ami anglais sur ce sujet. Il s'est servi des échantillons qu'il récoltait avec
tellement d'enthousiasme pour identifier l'origine des amphores. Près du col,
sur l'anse ou à la base de leur gros ventre, les amphores portent assez souvent
un sceau ou une simple marque. C'est la signature de l'artisan qui les a
tournées ou du commerçant qui les a commandées. En notant soigneusement toutes
ces indications et en les comparant à d'autres données connues des archéologues
méditerranéens, il réussit à esquisser une partie des grandes routes
commerciales de l'antiquité.
* * *
Après quelques mois à Chypre, il était prévu
que notre bateau passe le canal de Suez pour participer à un programme de
recherches scientifiques sur le corail tropical en Mer Rouge. Mais, tout
d'abord, il fallait aller à Beyrouth pour nettoyer et repeindre la coque.
A cette époque, dans les années soixante,
Beyrouth était encore la capitale d'un Liban heureux, hospitalier et fier d'un
luxe incomparable au Moyen-Orient.
Après le charme bucolique de notre mouillage
à Chypre, les bruits du grand port de Beyrouth paraissent affolants : la sirène
des cargos, le grincement des grues, le travail du chantier naval, les coups de
masse sur une coque, le petit soleil d'un soudeur, l'angoisse d'une scie à
métaux. Et puis, les arabes en pyjama qui s'engueulent au grand soleil, une
poignée de petits garçons tout nus qui crient en se poussant dans l'eau sale du
port et qui laissent sur la pierre du quai l'empreinte mouillée de minuscules
pieds.
Derrière le chantier naval, le grondement de
la grande ville moderne, ruisselante de publicités multicolores. Au fond du
cañon que forment les façades géométriques, un torrent de voitures, de trams
ferraillant sous des étincelles, de bars vibrants de musique rythmée et de
restaurants décorés en imitation orientale en Orient. Dans ce bouillon
mécanique, imperturbable, un mulet avec un vieux sac suspendu sous le derrière
pour récolter l'engrais, tire une charrette.
Couché sur le chargement, son patron, la casquette sur le nez, dort à poings
fermés.
Et au-delà de la grande ville, il y a
l'éternel silence des vastes montagnes libanaises. Le monde ancien des héros
phéniciens et des tailleurs de pierre blanche.
Ici, le rêve se mêle aux odeurs de
citronniers, du bateau que l'on repeint et des épices orientales. Les odeurs
n'ont pas d'âge. L'antiquité devait sentir le citron, la peinture à bateau et
le marché aux poissons.
Ce soir, c'est la fête, le bateau est prêt.
Demain matin, nous repartons pour l'Égypte et la Mer Rouge.
|
|
dessin à la plume de O.Gonet